Sommaire
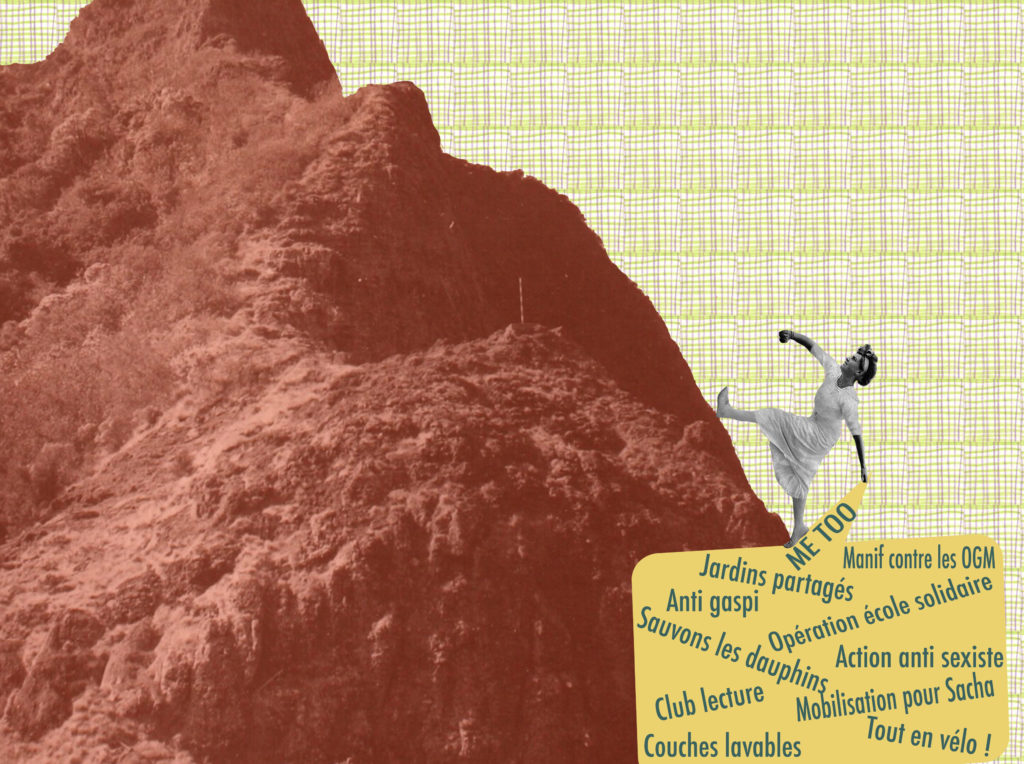
Le burn-out n’est pas réservé aux entreprises. Il s’infiltre jusque dans le militantisme. Dans notre société inégalitaire, cet épuisement guette différemment les femmes, qu’elles soient bénévoles ou salariées d’organisations qui luttent pour un monde meilleur. Rencontre avec plusieurs militantes fatiguées…
Nous connaissons tous·tes cette image. Une femme qui montre son biceps, point serré, un ruban rouge dans les cheveux. La phrase “We can do it” (“nous pouvons le faire”) est écrite au-dessus d’elle. Cette illustration de Rosie la riveteuse, la travailleuse américaine qui se relève les manches, est utilisée par les féministes depuis les années 1980 pour mettre en lumière la lutte collective pour l’égalité. Des militantes auxquelles axelle a tendu l’oreille ont cependant été contraintes de dire, à certains moments de leur vie : “Je ne peux plus le faire.” Elles renoncent, ne serait-ce que temporairement, à leur engagement, et souhaitent briser ce qui est encore un tabou pour beaucoup : le “burn-out militant”. En racontant leurs histoires, ces femmes engagées, mais épuisées, montrent qu’il doit exister de multiples manières de militer pour une cause.
L’implication sept jours sur sept
“Il y a plusieurs causes au burn-out militant. Je pense que la principale, c’est d’avoir trop de choses à faire. Tu commences par simplement t’impliquer, par être activiste, et puis tu découvres qu’il y a de plus en plus de dossiers sur lesquels te mobiliser”, explique Sarah, militante féministe [tous les prénoms ont été modifiés, ndlr].
« Comment est-ce que tu peux prendre une pause quand tu sais que des gens meurent de l’autre côté de la planète ? »
Emma est elle aussi féministe et son engagement a pris de plus en plus de place dans sa vie. Elle a, en outre, travaillé pour une organisation de défense des droits humains. Son militantisme laissait peu de place à la vie privée, dans une organisation qui semblait entretenir le chevauchement entre le personnel et le professionnel. Emma raconte : “Dans l’organisation où je travaillais, les gens s’impliquaient sept jours sur sept. Il n’y avait pas de pause ou de moment de repos. Comment est-ce que tu peux prendre une pause quand tu sais que des gens meurent de l’autre côté de la planète ? Il y a une forme de pression. Quand tu ne vois aucun collègue qui quitte son bureau à l’heure, tu ne le fais pas non plus”, continue-t-elle. Sarah poursuit : “N’oublions pas que nous vivons dans un monde capitaliste et que ces structures manquent de moyens. Quand ton activité militante est aussi ton boulot, tu sais que la réussite dépend de ton implication et du travail que tu feras en dehors de tes heures.”
Mathilde, quant à elle, est active dans la transition écologique et dans le féminisme. Elle a quitté son emploi salarié pour créer un salon de thé militant avec un ami mais elle a dû renoncer au projet. Elle confie aussi cette pression : “J’y ai mis tout ce qui me nourrissait en tant que militante, que ce soit dans les soirées qu’on organisait, dans la décoration ou dans les produits, qui étaient bio et locaux. On veut tout faire bien, il y a cette responsabilité. Je me suis mis cette pression toute seule. Malgré nos efforts, on a commencé à avoir des problèmes d’argent. C’était mon bébé… et ça ne marchait pas comme prévu.”
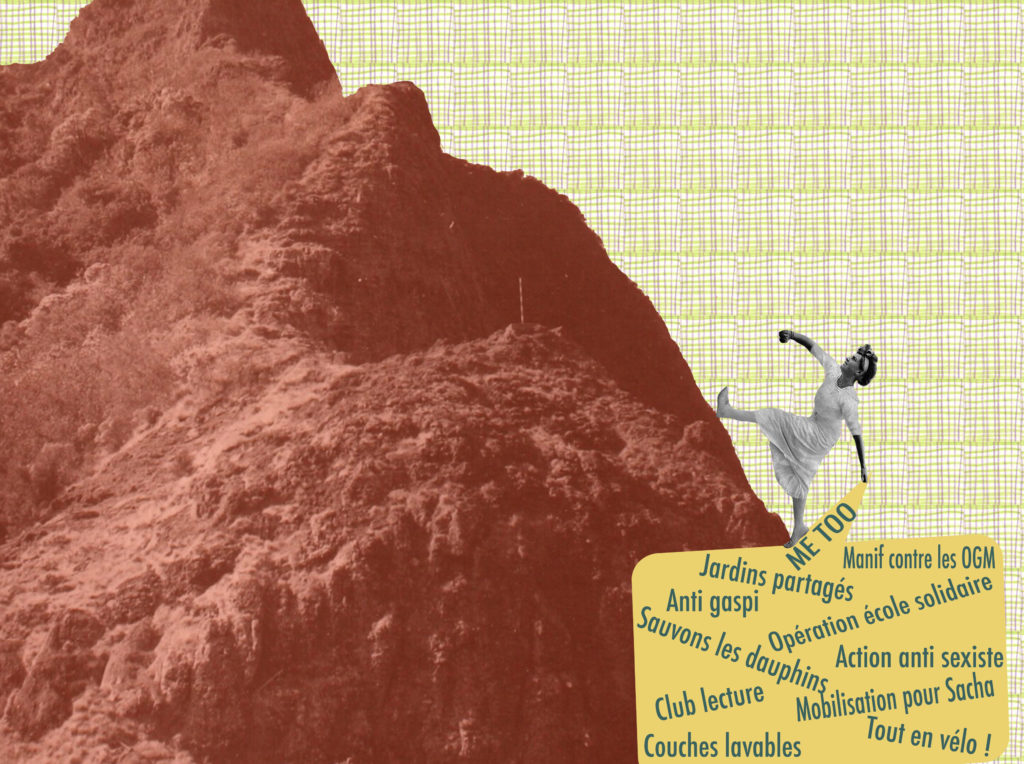
Enchaînées
À cette pression de bien faire s’en ajoute une autre : l’obligation de cohérence. On retrouve ce sentiment dans le récit que livre en 2017 Audrey Barat, ancienne journaliste devenue coach. “Je rêvais de voyager, mais ma voix militante-moralisatrice me disait que c’était mal, parce que ça polluait, et que le tourisme était source d’exploitation. Je rêvais de créer un lieu de bien-être, où les gens pourraient venir se ressourcer, mais ma voix de militante-moralisatrice me disait que ce lieu ne serait accessible qu’aux personnes qui avaient “les moyens” et que donc c’était mal. Je rêvais d’avoir une jolie maison, mais ma voix de militante-moralisatrice me disait que si je faisais un crédit à la banque, j’entretenais le système, et je m’enchaînais. Oui, j’étais enchaînée. Mais pas “au système”. À mon propre système. “
« C’est beaucoup plus fatigant d’être féministe quand tu es une femme, parce que tu vis les injustices que tu combats. »
Sarah confirme : “J’ai vraiment eu du mal à me trouver des hobbys. Tout ce qui m’intéressait, comme le crochet ou la danse, était trop connoté féminin et ça me dérangeait en tant que féministe.” Emma confie : “Ma vie est devenue le féminisme. Même à mon cours de chant, je choisissais des chansons féministes. Quand je voulais regarder des documentaires ou des films, je laissais tomber ceux qui ne montraient que des hommes blancs… Ça ne laisse pas beaucoup de choix ! J’ai aussi modifié mon langage, car je voulais inclure tout le monde. Alors j’ai commencé à dire “tous et toutes”, “quelqu’une”, etc. C’est très fatigant.”
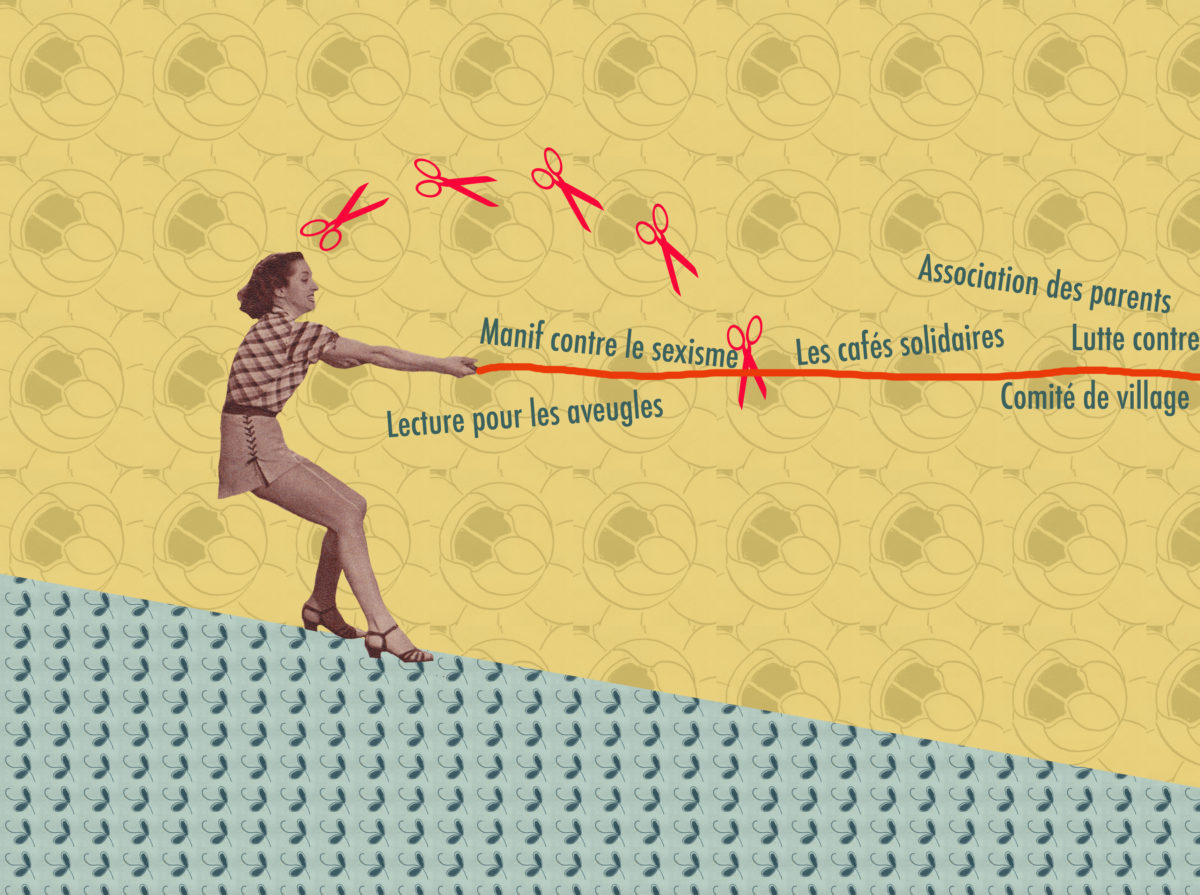
Difficile de se déconnecter
Même en plein burn-out, le lâcher-prise était impossible pour Laura, militante dans les milieux de la transition écologique et du féminisme : “Mes parents sont venus me voir alors que je n’étais même plus capable de sortir de mon lit. Ils ont réussi à me faire manger de la pizza surgelée industrielle quand même ! Mais au troisième jour, ça a été plus fort que moi, j’ai été au marché chercher des produits bio et j’ai cuisiné.”
*- À relire, un témoignage sur le “burn-out maternel : “Je ne ressentais pas cet amour, j’étais comme un zombie”
Comme dans les cas de burn-out “classique”, il n’est pas simple de se déconnecter quand même la vie sociale devient un champ de bataille. “Il y a les gens qui pensent que tu es la féministe de service et qu’ils peuvent te demander tout ce qu’ils veulent, tu es obligée de leur répondre. Il y a aussi ta sensibilité qui augmente quand tu milites : tu ne peux plus laisser passer certains propos tenus par ta famille ou tes amis”, explique Sarah.
À ce sujet, il y a le terrain des relations intimes. Par exemple, des militantes pour le bien-être animal peuvent vivre des conflits au moment des repas de famille ; des féministes peuvent être en relation avec des personnes pas forcément sensibles à la cause, ou simplement sexistes… Une charge mentale et un travail émotionnel supplémentaires sont alors au rendez-vous.
« Aujourd’hui, je suis en train d’apprendre à diriger ma colère. Je ne peux pas être en guerre contre tout le monde tout le temps. »
Mathilde en a fait les frais lorsqu’elle a décidé d’arrêter de se raser et de s’épiler, questionnant ainsi la peur des poils féminins. Elle a été critiquée par son entourage : “J’en avais vraiment marre des remarques de mes amis et de certains de mes amants. C’est constant et, au bout d’un moment, ça meurtrit.” Sarah acquiesce : “C’est beaucoup plus fatigant d’être féministe quand tu es une femme, parce que tu vis les injustices que tu combats. Ce n’est pas comme soutenir la cause animale par exemple, quand on sauve chats et chiens errants sans connaître leur sort.”
En d’autres termes, plus les femmes s’investissent dans le féminisme, plus elles découvrent des choses qui leur sont vraiment arrivées ou qui sont arrivées à leurs sœurs, à leurs amies, à leurs mères… Les injustices qu’elles combattent peuvent aussi survenir dans la période où elles militent, les obligeant parfois à se retirer d’une action pour s’occuper de problèmes personnels qui mobilisent toute leur énergie.
Enfin, discriminations ou violences peuvent les atteindre même dans le milieu où elles sont engagées si, par exemple, elles subissent des réflexions racistes dans un groupe féministe ou si elles sont considérées comme inférieures par rapport à d’autres militantes parce qu’elles n’ont pas fait d’études supérieures ou parce qu’elles portent le voile…
Quant à la transition écologique, elle pèse également plus sur les femmes. Un exemple : la campagne “zéro déchet”, qui implique l’utilisation de bocaux renouvelables lors des courses, le recours aux couches lavables et aux produits ménagers écolos ou faits maison. Dans une société où les tâches ménagères sont toujours massivement réalisées par les femmes, ce sont bien elles qui vont devoir gérer les contraintes du zéro déchet en premier…
Culpabilité et colère
Les activités militantes peuvent être professionnelles ou bénévoles, elles peuvent avoir lieu le matin comme le soir. Il s’agit de telle conférence qu’il ne faut pas rater, de tel documentaire à voir, de telle formation qu’il faut absolument suivre. De cette profusion d’activités naît une culpabilité quand on se rend compte qu’on ne peut pas tout faire. “Oui, cette culpabilité existe, ce qui est étrange parce qu’il n’existe pas de “bonnes” ou de “mauvaises” militantes… Je culpabilise aussi quand je ne réponds pas à des propos sexistes”, précise Mathilde. Sarah explique : “C’est vrai que tu te sens vite obligée d’en faire toujours plus et que tu culpabilises quand tu décides de te mettre en retrait.”
Cette culpabilité doit être analysée avec des lunettes de genre : les femmes culpabilisent plus que les hommes. Ce n’est pas une émotion ressentie égalitairement, elle est apprise et entretenue par la société (voir axelle n° 213). “Alors qu’en tant que militantes, nous parlons tout le temps de politique et de combats collectifs, nous restons très seules face à notre culpabilité. Il y a un travail à faire là-dessus”, continue Sarah.
Parmi les autres émotions ressenties par les militantes et qui participent à cette spirale d’épuisement, la colère revient en premier lieu. Laura raconte : “Quand je suis arrivée dans mon asbl, j’étais pleine d’espoir, j’allais enfin faire quelque chose d’utile. Mais au sein de l’équipe en place, il y avait beaucoup de colère et de lassitude. J’ai vite perdu mon énergie positive.” Mathilde observe : “Aujourd’hui, je suis en train d’apprendre à diriger ma colère. Je ne peux pas être en guerre contre tout le monde tout le temps.” Pour Sarah aussi, “quand on constate tout le travail qu’il reste à faire, on peut se sentir triste, déprimée et en colère. Cette colère peut être mobilisante, mais si on la ressent en permanence, on est tirée vers le bas.”
Lorsque plus rien ne tire vers le haut et qu’on se retrouve tout en bas, c’est le début du burn-out. Parmi les femmes que nous avons rencontrées, celles qui en sont revenues disent le stress, les nuits d’insomnie et les crises d’angoisse : des symptômes typiques du burn-out. “Pour moi, la sonnette d’alarme a retenti quand j’ai commencé une crise d’angoisse au boulot. J’en faisais déjà la nuit, donc ça y est, j’allais en faire jour et nuit…”, se souvient Mathilde.
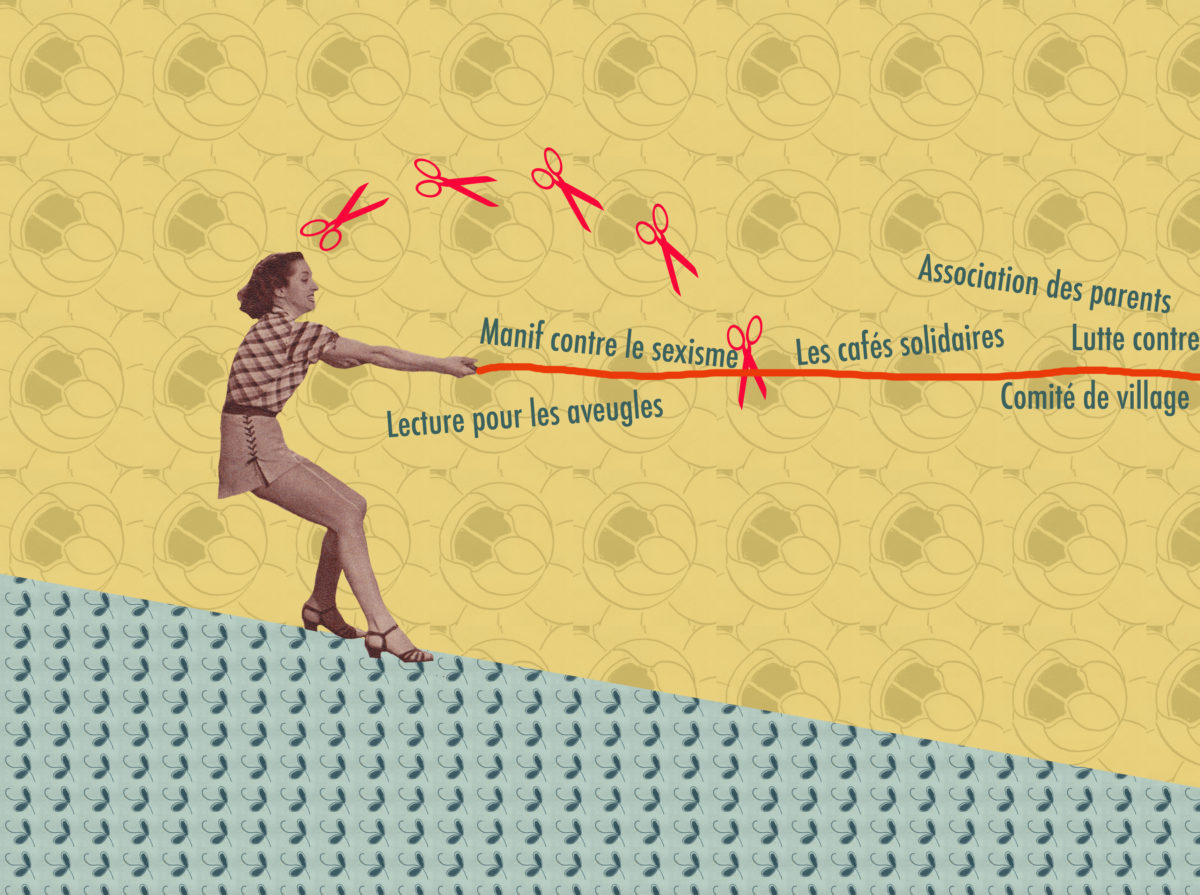
Prendre soin de soi : “un acte politique” ?
Pour ces militantes au bout du rouleau, l’échappatoire se trouve peut-être dans un concept féministe, celui du “care”, qui permet de comprendre que ce sont majoritairement les femmes qui s’occupent des autres, qui prennent soin. Mais pas d’elles-mêmes ! La philosophe américaine Joan Tronto a tenté de trouver une éthique du care, en critiquant cette division sexuée des tâches entre femmes et hommes. Elle nous confiait que ce sujet était pour elle “une préoccupation féministe à propos de la vie des femmes, afin qu’elles puissent alléger leur fardeau.” Ce “fardeau” peut se prolonger dans la vie militante, comme on le voit dans les témoignages des femmes que nous avons rencontrées. D’où l’importance de prendre soin de soi, pour sa santé mentale et physique.
Pour Sarah, “c’est un acte de résistance de s’écouter, un acte politique. C’est une continuité de l’action militante. Des moments de pause sont importants, d’autant plus que cela prend du temps d’apporter des modifications dans la société : il faut tenir sur la longueur. Plus on cumule personnellement des discriminations, plus on est fatiguée et plus il faut prendre soin de soi. Quand on fait une pause, le collectif prend la relève !”
Il faut donc se laisser du temps quand on est engagée… et aussi trouver de la joie dans son engagement. À ce sujet, Sarah pense que “nous avons besoin d’un espace pour faire vivre la joie dans le monde militant. Il nous faut un endroit où nous pouvons nous réjouir de toutes nos avancées plutôt que de nous concentrer sur ce qu’il reste à faire et sur nos échecs. Un endroit où on ne se critiquerait plus, mais où on serait contentes de la diversité de nos mouvements. J’ai cherché cet endroit, je ne l’ai jamais trouvé.”
De quoi se rappeler la fameuse réponse d’Emma Goldman, féministe et anarchiste russe, à des théoriciens de la révolution qui ne pensaient qu’au sacrifice : “Si je ne peux pas danser, je ne veux pas faire partie de votre révolution !”
Merci à Vanessa D’Hooghe, qui a contribué à nourrir ce dossier.
Militer sur la longueur : quelques pistes
Attention ! Ces conseils (inspirés par les personnes rencontrées dans le cadre de l’article, par des expériences de mouvements féministes et par des lectures de blogs anglophones) ont simplement pour but de nous aider à mieux vivre notre militance personnelle et bénévole en l’articulant aux différentes sphères de notre vie, y compris le soin de soi, et de repousser le burn-out. Ces conseils ne peuvent remplacer, dans le cas d’un burn-out avéré, une prise en charge adaptée (médicale, psychologique et sociale). Dans le cas professionnel, vous pouvez notamment vous adresser au service de prévention et de protection au travail de votre organisation. Certains services ont par exemple une unité psychologique qu’on peut contacter directement et individuellement en tant que travailleur/euse.
- Se dire qu’on en fait déjà beaucoup.
- On n’est pas obligée d’être militante à plein temps : on ne doit pas tout le temps monter au créneau sur tous les sujets.
- En tant que bénévole, on a le droit de faire une pause à tout moment. Et même de ne plus militer du tout si l’on souhaite.
- Si on s’arrête, la lutte ne s’arrête pas.
- Ne pas opposer “soin de soi” et militantisme.
- Trouver des hobbys dépourvus de lien avec notre militantisme (activités créatives, culturelles, sportives…).
- Soigner nos liens avec les personnes qui nous sont chères en dehors de notre engagement.
- Se réserver des moments de joie et de partage… et les mettre aussi à l’agenda collectif !
- Prendre du plaisir au moment même dans ce que le militantisme a de positif à offrir (liens, solidarités, émulation), sans forcément attendre le “résultat” pour se réjouir.
- Laisser tomber l’obligation de cohérence : ne pas renoncer à tout ce que nous aimons et qui nous fait du bien sous prétexte que ça ne respecte pas notre vision d’un monde meilleur. Nous sommes à cheval entre l’ancien monde et le nouveau : les incohérences font partie du chemin. C’est nécessaire pour changer le monde… tout en y vivant.
- Se couper momentanément du flux des informations, surtout des journaux et des réseaux sociaux.
- Être attentive aux moments où on est à la fois militante et touchée par les violences et les discriminations qu’on dénonce, pour repérer les circonstances où il est nécessaire de reprendre des forces avant d’y retourner.
- On ne doit pas porter toutes les luttes. On ne peut pas. D’ailleurs, parfois, d’autres personnes sont plus légitimes. Mais soutenons-les et entretenons des liens avec les autres luttes. Cela baisse la charge de travail et renforce les solidarités. Tout bénef, pour éviter l’épuisement.
- On n’est pas obligée d’occuper toujours la même place dans l’action. Il y a de la place pour toutes : au front, mais aussi en soutien, pour contribuer sans s’exposer quand on en a besoin.
- Sur la concurrence dans le milieu associatif (et sur les burn-out qui y sont liés), l’asbl Barricade a publié une analyse éclairante avec des pistes d’actions concrètes pour les asbl.
- Une boîte à outils pour le bien-être au travail dans le secteur non-marchand à découvrir ici.















 Bruxelles
Bruxelles
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info